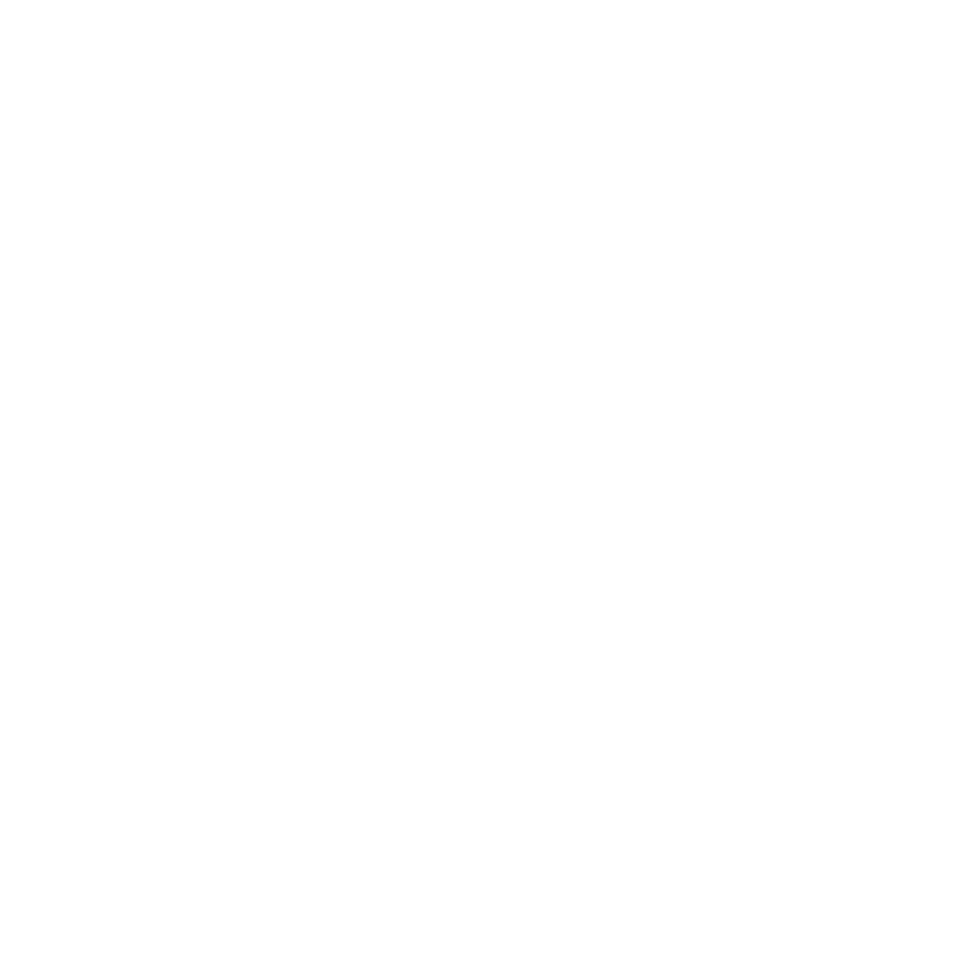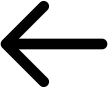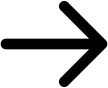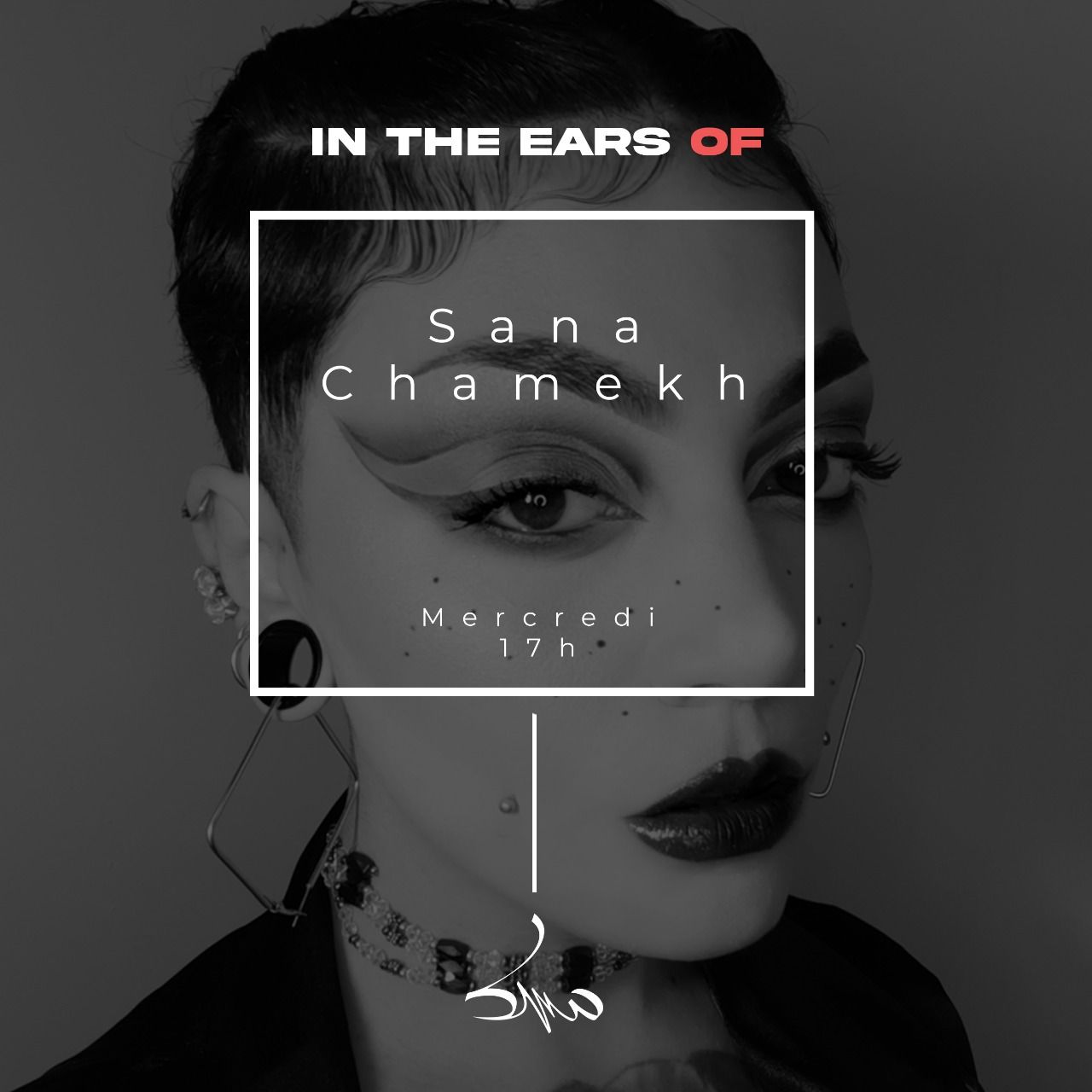Tu peux… détester le football ou Kusturica, être fan de Milan ou de la Juventus, être brésilien ou anglais, avoir eu pour idole de jeunesse Platini ou Zico lorsque la RAI était notre ouverture à la crème du football mondial, ne pas supporter d’entendre Life is life, être supporter de River Plate, être anticastriste de base, ne jurer que par Pelé, ou même être le seul membre du fan-club de Ali Bennaceur. Aujourd’hui, l’effet est le même que si on t’annonçait que Dieu était mort.
Car Diego Armando Maradona avait en lui quelque chose de divin -de diabolique aussi. Comme l’écrivait Omar Khayyam, « les deux sont en toi », et les deux furent assurément en lui. Divin, un talent aussi surnaturel, qui lui fit remporter encore mineur le titre de meilleur jongleur du monde (devenu une sorte de concours de cirque depuis). Qui fit dire de lui par son petit frère (futur professionnel lui aussi) « je ne serai jamais aussi bon que lui, mon frère est martien ». Qui lui permit d’associer talent pur et instinct naturel, et en faire le meilleur joueur du monde. Diabolique, cette envie de gagner à tout prix qui est la marque des champions mais qui parfois fait franchir les limites, comme ce fameux but de la main, mais aussi cet attentat sur Zico en 1982, cet arrêt sur la ligne en 1990 face aux soviétiques, ce présumé chloroformage du Brésil en 1990 ou cet appel à la sécession aux napolitains.
El Pibe de Oro
En fait Diego était tout simplement humain, hormis sur le terrain. Un gamin en or, par son talent, de cet or dont l’éclat appâte malheureusement toute la faune des chercheurs du précieux métal. C’est d’ailleurs lorsqu’il remplace en guise de manager son ami d’enfance Jorge Cyterspiler par le ‘mondain’ Guillermo Coppola que Dieguito commence sa descente aux enfers. Mais c’est ce qui va forger encore plus sa légende : Maradona n’a jamais cherché à masquer ses défauts ni ses frasques. Loin de vouloir présenter une image policée comme le font les vedettes d’aujourd’hui, loin de vouloir masquer ses origines prolétaires, il revendique ses frasques, les exagère même -au point de nous laisser aujourd’hui orphelins avant l’heure. El Dios se déclare communiste, lui à qui l’on a consacré un culte religieux. Encore une fois les extrêmes sont en lui.
C’est cette humanité, cette simplicité d’esprit qui nous a tous fait l’aimer. Il se comportait en jouant comme le gamin que nous sommes tous resté, surtout quand un ballon est en jeu. Inutile de vous narrer ici son palmarès, contentons-nous de rappeler que Naples n’a jamais gagné le championnat d’Italie hormis avec lui, et que nul autre joueur ne survola un tournoi ni n’écrasa partenaires et adversaires comme il le fit à la Coupe du Monde 1986 (Pelé avait Rivelino, Jair ou Tostao pour ne citer qu’eux). Inutile aussi de revenir sur sa pénible fin de carrière de joueur à valises, ou ses insuccès comme coach -Mozart ne peut pas enseigner aux autres ce qui est inné chez lui. Mais souvenons-nous qu’après ses titres, ses records de joueur le plus onéreux du monde (deux fois de suite), de précocité, ses écarts, les films ou chansons qui le statufièrent vivant, lorsqu’on lui demanda quel surnom lui plaisait le plus parmi la dizaine qui lui furent attribués il retint ‘Pelusa’( : peluche).
« Pelusa. Parce que ça ramène à une époque, celle des Cebollitas (NDLR : son équipe de quartier), où tout ce qui comptait c’était le jeu, le terrain, et où tu étais le roi du monde en recevant un coca comme prime de match ». Merci Diego.