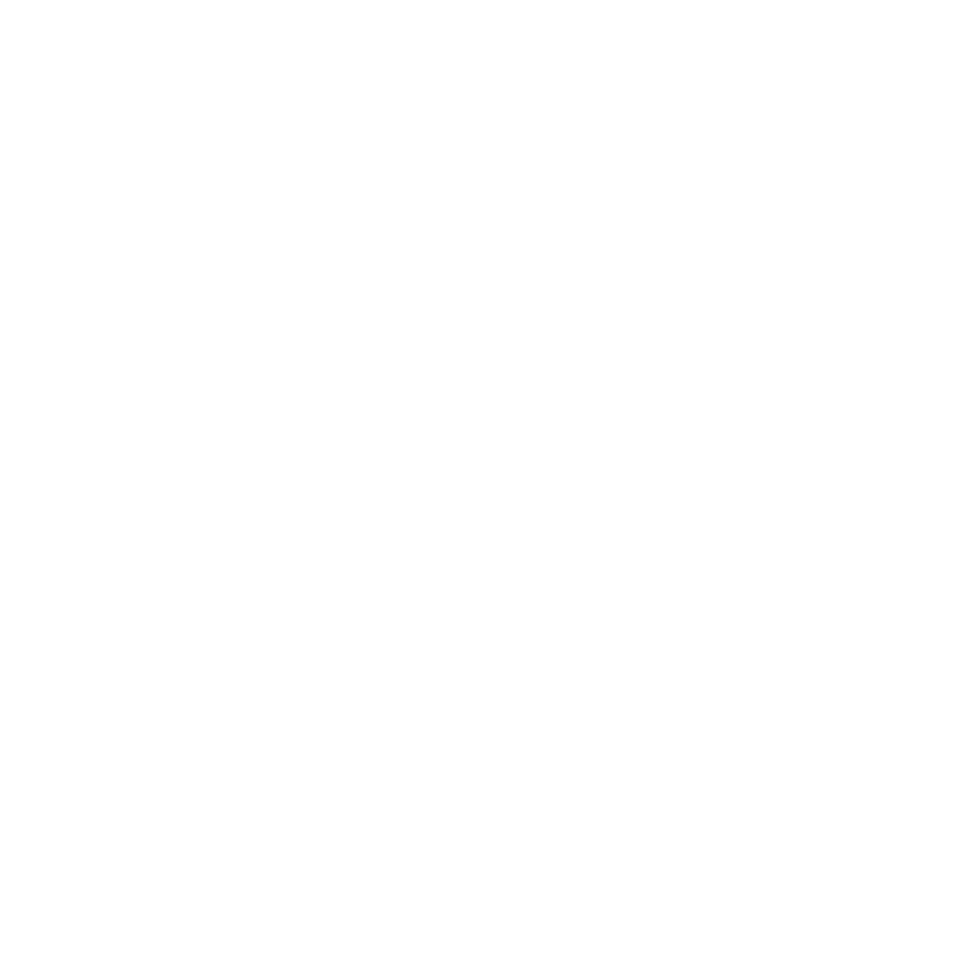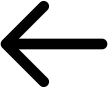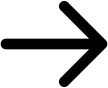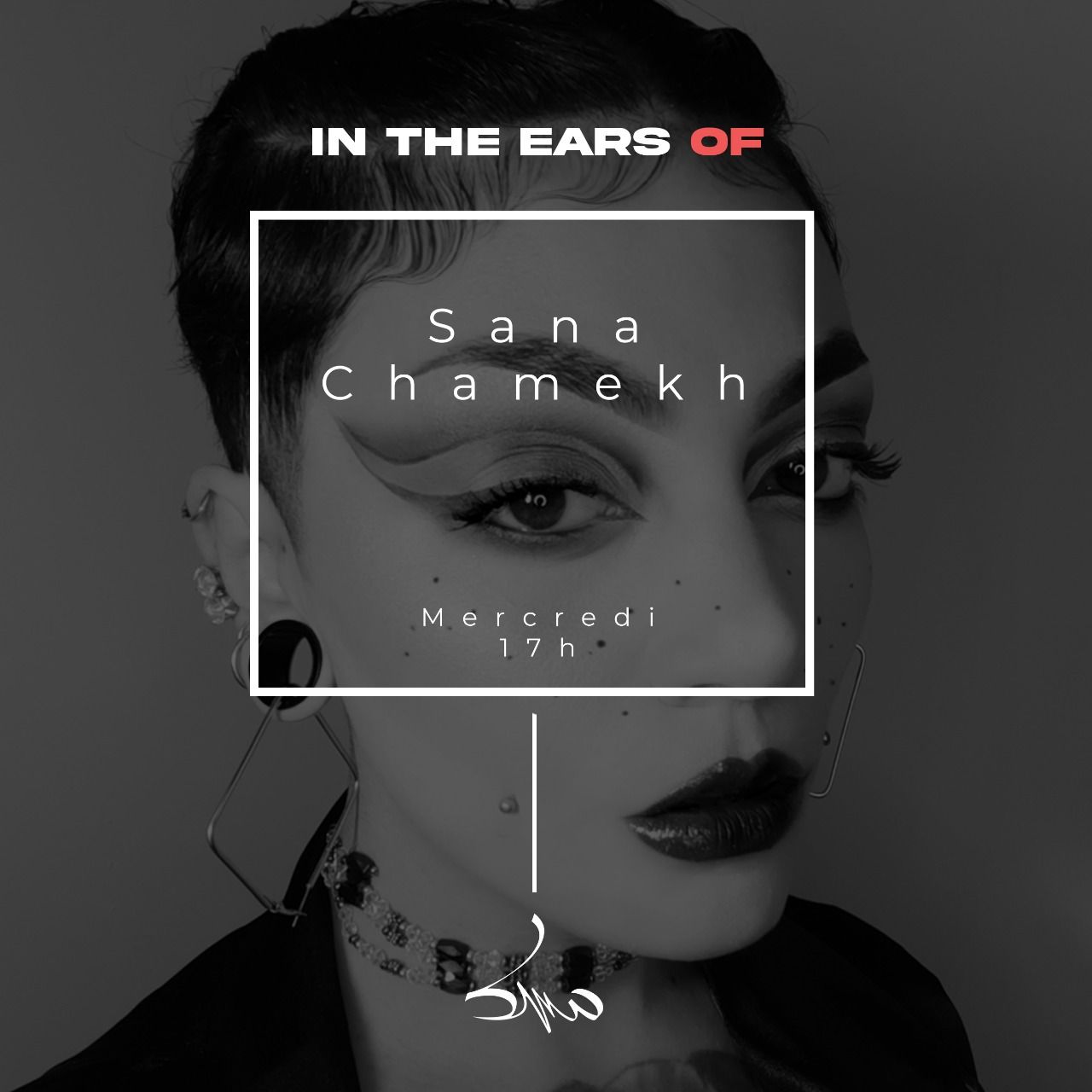La pièce de théâtre "Labyrinthe", mise en scène par Dhafer Ghrissa, a été présentée, mercredi 22 mars, à El Teatro, lors de la 12ème édition de «L’Avant Première des Arts de la Scène». Du Théâtre de la cruauté.
Interprétée par Nafissa Boudali, Mehdi Ben Aissa, Mohamed Ali Blaiech, Chiheb Maddeh, Imen Solimane, Mariem Soufi, Dhouha Harzallah, Lobna Toukabri et Firas Salmi, Labyrinthe est une pièce qui esthétise la folie, l’oubli, la torture et la violence.
La souffrance d’exister, la mort, l’oubli, les maux et la terreur qu’évoquent les mots… ainsi se dévoile la pièce Labyrinthe; un théâtre de la cruauté. Dans une scénographie qui rappelle à la fois la prison, l’asile psychiatrique et le cimetière, se dénudent les visages des acteurs prisonniers à chaque scène de leurs bandages, telles des momies retrouvant momentanément la vie et un visage à leurs souffrances, le temps d’une représentation.
L’oubli, l’un des pires instruments de torture.
On n’existe que par la mémoire de l’autre. Ainsi se succèdent les monologues absurdes et juxtaposés qui s’étalent sur la nécessité d’exister pour l’autre. Ces personnages morts-vivants avaient cessé de vivre. Dans un non-espace-temps, ils se retrouvent cloîtrés et séquestrés par la notion aléatoire et arbitraire qu’est la mesure du temps.
Leur bourreau, violent, cynique et sadique, personnifié en un médecin-horloger, les maltraite, les rabaisse, et leur rappelle que chacun d’entre eux n’est que misérable individu. L’individu perdant de sa valeur, dès qu’il abandonne son appartenance. Médecin pour représenter le pouvoir sur le corps et l’intégrité physique. Horloger pour rappeler l’emprise du temps, et le passage insignifiant qu’est une vie individuelle.
Cesse-t-on de valoir quelque chose une fois son devoir de sauvegarde de la mémoire collective abandonné? C’est ce que semble délivrer comme message cette pièce qui s’est donné peut-être pour axe principal un éloge pour l’Humanité.
De l’humour noir, pour reproduire la séquestration subie
Le premier acte de la pièce se termine par une sortie de scène fracassante. Le public est même presque violenté verbalement et visuellement par ces interprètes qui frisent la folie, pour donner suite à un deuxième acte qui contracte avec le premier sur le ton.
On y découvre de l’humour noir, du cynisme et de la légèreté. Des allusions sexuelles, gores et morbides à la fois. Un éloge à l’absurde riant.
Les personnages sont des morts déterrés, ou alors juste des habitants du cimetière, qui vivent à la marge, en fuite, pour avoir commis on ne sait quoi.
Ils sont par contre rattrapés encore une fois par leurs bourreaux, qui étaient les victimes du médecin-horloger lors du premier acte.
Il menace de procéder à des tests anaux, à des tests d’urine pour y trouver des traces de résine de marijuana. On menace de tout. C’est le corps, bien que mort, qui est dans la ligne de mire de cette police des mœurs.
Labyrinthe de paradoxes.
Tout est dénoncé dans cette pièce. L’arbitraire, l’oubli, la violence, la passivité. Et pourtant, quelques répliques ne font qu’attirer l’oreille sur certaines incohérences, ou peut-être est-ce juste un paradoxe voulu et recherché par le dramaturge metteur en scène.
«Les femmes d’abord», dit l’homme victime, en voulant que la femme victime passe à l’interrogatoire-torture avant lui.
«Oui, les femmes d’abord, répond-elle, je suis plus “homme” que toi», avant de s’éclipser et le laisser en tête à tête avec ses bourreaux.
Une femme qui se dit homme pour se valoriser. Une femme qui traite un homme de femme pour le dévaloriser. Est-ce là un message à comprendre?
Pour finir, la pièce est une recherche sur la violence, la cruauté et l’absurde. Elle finit sur un salut, où la scène est partagée en deux par un fil de sable qui rappelle le sablier qu’on vient à peine de retourner.
La pièce vient à peine de commencer, et pourtant c’est la fin? C’est peut-être pour rappeler la cantatrice chauve d’Eugène Lonesco, où la pièce recommence en boucle à chaque fois où elle finit, jusqu’à ce que s’effondrent de fatigue les interprètes. Et la vie est faite ainsi.
Photo : Dhafer Ghrissa